|
|
SEIGNEURIE, VICOMTÉ
ET CHÂTEAU D 'ÉVOL
Les plus anciennes
mentions du lieu d'Évol, à notre connaissance, sont données
par le Marca Hispanica :
957 - Donation au monastère de Ripoll, par le comte Seniofred
: «... Et est ipse alodes in Valle Confluente, in suburbio Elenense, villa quae dicunt EVOLO vel
in ejus fines, id est, casas, casalibus, curtis curtalibus ... » (jardins, vergers,
terres cultes et incultes, vignes, forêts, garrigues, prés, pacages, moulins, etc.) dont les confronts sont d'un
côté « Monte Tornado vel in villa Bardolio et in rivo Oleta », de l'autre côté «
in Vilioles » (Jujols), du troisième côté
« in ipsa Erola » et du quatrième, « in flumine Tedo » (Marca
n° 92).
En 1011, le pape Serge IV confirme les propriétés
de l'abbaye de Ripoll, parmi lesquelles :
« In valle Confluenti alodem qui dicitur Evol cum ipsas
salices et pasturas » (Marca n° 165).
Ainsi, l'alleu d'Évol appartenait entièrement à
Ripoll à cette époque, et un précepte du roi Lothaire le précise en 982 (Marca n° 131).
D'autre part Évol est cité comme lieu où
d'autres abbayes ont quelques terres :
981 - Diplôme de Lothaire pour Sant Genis de Fontanes (Marca
n° 129).
985 - Bulle de Jean XV pour Cuixà (Marca n° 135).
1011 - Bulle de Serge IV pour Cuixà (Marca n° 164).
Malheureusement, il y a ensuite une énorme lacune dans
les archives d'Évol, entre 1011 et le règne du roi Pierre d'Aragon (1196-1213), où le Liber Feudorum
(30) cite en note, sans en donner copie, une charte de ce souverain par laquelle celui-ci donne en fief
à Raimon Roger, comte de Foix, les villas d'Évol et Estavar et les châteaux de So et
de Cher Agut (Quérigut).
Ainsi, entre-temps, l'alleu d'Évol était devenu
fief royal on ne sait comment.
Il faut attendre presque un siècle pour qu'il soit de nouveau
question d'Évol. En 1260, en effet,Guillem de So reçoit l'investiture féodale
des châteaux de Sahorra, Eus, Puigvalador et Évol,
auxquels s'ajoutent en 1266, So et Queragut, des mains du roi
Jacques I « Le Conquérant » (31).
Un peu plus tard, en 1276, lorsque Jacques I de Majorque succède
à son père, il reçoit l'hommage
féodal de Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn
et de Castellbo, pour les châteaux de So et de
Queragut, tout le pays de Danaza, les lieux de Stavar, Bajanda
et Évol, plus divers droits et
possessions en Capcir, Cerdagne et Barida provenant de l'ancienne
vicomté de Castellbo (32).
À l'avènement du roi Sanche (1312), Gaston de Foix
renouvelle son serment, ainsi que Bernard
de So, seigneur d'Évol, pour le château
de Salto et le vilar de Creu en Capcir (33), et Guillem de
So, seigneur de Rocafort, pour divers droits et manses sis
à Riutort (34).
(30) Fr. Miquel
Rosell, Liber Feudorum Major, arxiu de la Corona de Aragon, Barcelona,
1947, t, II, p. 386, note 2.
(31) Archives Départementales des Pyr.-Or., série
B. N° 190
(32> id B 16
(33> id B 16. — Il ne paraît pas s'agir ici du château
de Sauto, près de Montlouis, mais d'une fortification inconnue, beaucoup plus proche d'Évol. En effet, le Liber Feudorum
Major donne copie d'un serment féodal prêté au roi
Anfos
(1162-1196) par un certain Bernadus Bertrandi « Ego Bernadus
Bertrandi, nominatim juro tibi Ildefonso, domino meo regi
et comiti, castellum de Conat et rocham de Sexman et castellum
de Salto et omnes fortedas que ibi sumt aut in antea erunt »
(t. II, p. 163). Le château de Conat et la Roca de Salimans
existent toujours et sont dans la Vallée de Nohèdes, il
est donc
probable que ce castell de Salto s'y trouvait également.
(34) Arch. Dép. B 16.
Puis
ce même Guillem de So rend hommage à Bernard de So pour
la moitié des dîmes de
Formiguera, Riutort, Caselles, Sposolla et Gualba, tous en
Capcir, le tiers de celles de Paracolls
et Molig, un fief à Campôme et Fornols, etc... (35).
On ne sait pas exactement à quelle date la seigneurie d'Évol
fut érigée en vicomté ; certains auteurs
disent qu'elle fut contemporaine de la création des vicomtés
d'Illa et de Canet. Mais on trouve l'acte de
concession du château et de la fortia de Llivia, et du baillage
de la même ville, faite par Jacques II de
Majorque en faveur de Joan de So, vicomte d'Évol
(36). On sait aussi qu'en 1344, le vicomte d'Évol
et, avec lui, tout le Conflent restèrent jusqu'au
bout fidèles à la cause perdue de Jacques II.
Sous le règne de Jacques II, Bernard de So,
fils de Guillem et de Gueralda, fit cession de sa
seigneurie de Cortsavi, du château de la Bastida,
dans les Aspres et des dîmes de Prats-de-Molló
au roi de Majorque, en échange des châteaux
de Calce et de Miliars (37). À la même époque, l'Infant
Ferrand de Majorque vend à Jean de So, vicomte d'Évol,
des droits de fief sur les châteaux de Miliars
et de Calce ; celui-ci en fait prendre possession par son procureur
Dalmace Dez Volo (38). C'est le
même Joan qui fit construire, en 1340, le château
de La Bastida d'Évol (ou d'Oleta) et avait reçu du
roi de Majorque la juridiction militaire sur tous les châteaux
du haut Conflent.
Il paya sa loyauté envers son souverain, et les faveurs
qu'il avait reçues de lui, par l'exil et la
confiscation de tous ses biens, en 1344, lors de l'effondrement
du royaume de Majorque.
Deux châtelains au moins, nommés par Pierre IV d'Aragon,
se succèdent au château d'Évol,
d'abord Dominique de Puig Molto qui est envoyé peu après
à Puigvalador et remplacé par Benoit
Tuiscle (39). Puis Pierre IV cède en fief honoré,
à Bernat Guillem d'Entença, les châteaux et lieux
d'Évol, Salto et Bastida d'Oleta (40).
Plus tard, Bernard de So, fils de Joan, réussit à
récupérer la vicomté et vendit à Pons Dez
Catllar,
donzell, toute la châtellerie de LIivia qu'il tenait de
son père.
Néanmoins, Joan de So avant de mourir avait lui-même
repris son titre de Vicomte d'Évol et reçu de
Pierre IV, Ayguatèbia, Jújols et le château
de Celrà (41).
Bernard de So avait épousé Bianca de Aragall (42)
et eut un fils, Arnald qui hérita de la vicomté
(43).
Vers 1390, on trouve l'aveu féodal fait par Bernard de
So, vicomte d'Évol, au Procureur royal pour la
moitié des dîmes de Formiguera, Riutort, Esposolla
et Galba et un manse à Anglars, en Capcir ; le
tiers des dîmes de Paracolls et Molig et diverses possessions
à Campôme et Fornols (44).
En somme, presque le même acte que Guillem de So avait fait,
quelque 70 ans plus tôt.
(35) Il avait épousé Gueralda, sœur
d'Arnald de Cortsavi, et eut un fils, Bernard qui fut seigneur de Cortsavi (id B 57 et 85)
(36) Arch. Dép. B 253.
(37 - 38) id B 14.
(39) id B 97. (42) id
B 367 et 145.
(40) id B 367. (43) id B 126.
(41) id B 190. (44) id B 153.
La
reine Marie d'Aragon, lieutenant général du roi Marti
son époux (1396-1410) retenu en Sicile, nomme
le vicomte d'Évol capitaine général en Cerdagne
et Conflent et lui ordonne de réparer et approvisionner
les châteaux royaux (45). À la même époque,
le procureur de Hug de Faye, camérier de La Grasse et
seigneur de Prada, présente Arnald Garriga, bourgeois de
Perpinyà, qu'il a nommé capitaine du
château de Prada, à Bernard de So, vicomte d'Évol
et capitaine général, pour la confirmation de cet
office (46).
Par lettres du roi Marti, il est fait défense au vicomte
d'Évol de faire reconnaissance de ses fiefs
d'Évol, Estavar, Callastre, Bajanda et Nasovell, réclamée
par Ysabel, comtesse de Foix, en qualité
de vicomtesse de Castellbo. Ces lieux devant être tenus
directement en fief pour le roi, d'après les
anciens documents (47).
1412-1416 : ordre de mettre à exécution une sentence
concernant la devèse dite Causma, tenue en
fief pour le roi par Guillem de So, vicomte d'Évol,
héritier de Noble Joana de So, épouse du donzell Ça Tor et dont les habitants de Puigvalador réclament
la propriété (48).
Guillem de So, vicomte d'Évol, est encore cité jusqu'en
1422 au moins (49) ; il vend la haute justice,
host et chevauchée du lieu d'Ayguatebia au Chapitre d'Urgell
(50), il est seigneur de Fontrabiosa (51),
il signe l'acte de Suppression du privilège exclusif de
descharregador à Cotlliure. Désormais on peut débarquer en n'importe quel coin de la côte roussillonnaise
(52).
1469 : Louis XI envahit les comtés de Roussillon et Cerdagne
; les trois vicomtés d'Évol, Illa et Canet
sont confisquées et données à Cyr Monner
(53) ; les lieux et châteaux de la Bastida d'Évol, d'Estavar
et tous les autres revenus que le vicomte d'Évol possédait
en Cerdagne et Conflent sont cédés au
donzell Damien Dez Catllar (54).
Charles VIII ayant restitué les comtés à
l'Aragon, Évol retrouva ses anciens seigneurs. Les fils de Francesch de So de Castro y de Pinos, vicomte d'Évol,
obtiennent franchise des droits de lods pour
l'acquisition des lieux d'Estavar et Bajanda (55).
1496 : réclamation par Philippe de Castro, vicomte
d'Évol, au sujet d'une saisie de ses revenus de
Berguja en Cerdagne (56).
1497 : Procès du vicomte d'Évol, seigneur de Berguja,
contre les habitants de Bor, pour que ces
derniers ne puissent exercer aucun droit de dépaissance
ni autre sur le territoire de Berguja, qui
appartient en franc alleu audit vicomte. Comme Berguja est détruit
à cause de la guerre, ses habitants
se sont établis ailleurs, mais l'usage du pacage doit leur
être réservé (57).
1511 : Joan Dorcha, avocat, procureur des fils mineurs du vicomte
d'Évol, demande une copie de l'acte de fondation de la vicomté d'Illa (58).
(45) id B 163. (52)
id B 232.
(46) id B 161. (53)
id B 292.
(47) id B 185. (54)
id B 408.
(48) id B 202. (55)
id B 357.
(49) id B 203, 214 et 215. (56) id B 414.
(50) id B 219. (57)
id B 415.
(51) id B 226 (58)
id B 418.

Château d'ÉVOL : vue d'ensemble.
1530
environ : Guillem Ramon Galcerand de Castro est vicomte d'Illa,
Canet et Évol (59).
1638 : Procès contre Elisabeth Inès de Eril,
veuve de G-G. de Gurrea Aragon Castro y Pinos,
vicomtesse d'Évol, au sujet du service militaire dû
pour les châteaux de la vicomté. Lettres de Philippe
IV lui ordonnant de comparaître à Puigcerdà
pour les services qu'elle doit pour le fief du château de
Salto, à cause des menaces d'invasion du Roussillon. La
vicomtesse allègue que les fiefs qu'elle tient
sont honorés et tenus à aucun service militaire
et que le château de Salto est complètement ruiné
et
ne peut assurer aucune défense. Elle est néanmoins
condamnée à fournir deux hommes avec armes, équipement et chevaux (60).
1653 : l'invasion prévue a eu lieu, Vilafranca assiégée
a capitulé et les confiscations reprennent de plus
belle. Les biens du vicomte d'Évol sont attribués
à don Joseph Margarit, marquis d'Agullar (61).
(59) id B 368.
(60) id B 389.
(61) id B 394.

Fig. 1 — Château
d'Évol : tour nord-ouest et remparts.
CHÂTEAU
D'ÉVOL
Le territoire d'Évol se compose uniquement d'un ravin long
de 10 km environ, qu'un petit torrent appelé Rivière d'Évol a creusé peu
à peu, en étroit couloir entre le Mont Coronat (2 147
m) et le Puig d'Escoto (2293 m). Ici, pas le moindre riveral ; des pentes bien
près de la verticale s'élèvent dès le ruisseau où aucun gué n'est possible. Avec une patiente
ténacité, les paysans ont soutenu la terre arable par des murs de pierre sèche, formant d'innombrables
terrasses en escalier jusque très haut sur les parois du ravin. Elles sont si étroites que cela
fait finalement très peu de surface réservée aux cultures. Plus haut commencent d'immenses pâturages où
l'on dénombre encore une centaine de bergeries, pour la plupart en ruines.
Un très ancien chemin se faufile difficilement de flanc,
passant d'une rive à l'autre par cinq ou six ponts de pierre. Il vient de Nohèdes par le col de Ports, traverse
les deux hameaux de Thuir et d'Évol avant d'aboutir, 3 km plus bas, à Oleta.
Un contrefort issu du Mont Coronat tombe entre les deux hameaux
après avoir formé un dernier ressaut ; c'est là qu'est le château.
Celui-ci présente le plan d'un quadrilatère flanqué
aux angles de 4 tours rondes. Cette caractéristique prouve déjà, sans l'aide des documents, qu'il fut
construit après la guerre albigeoise, probablement vers 1260, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Il peut également
avoir succédé à une petite fortification antérieure, non considérée comme castrum
; le cas est fréquent.
L'habitation du seigneur occupe l'aile occidentale ; écurie
et communs formaient l'aile orientale aujourd'hui presque entièrement ruinée, autour d'une
cour intérieure. La porte principale s'ouvrait au milieu du front sud (disparu) comme en témoigne un vestige
de la rampe d'accès.
*
*
*
Les
défenses du château
Lorsqu'on pénètre dans le château par cette
entrée, on a sur sa droite le rempart oriental en place,
de bonne épaisseur (2 m), percé d'une poterne (fig.
2). Sur une bonne moitié de la longueur du rempart, des arrachements de voûte signalent l'existence d'une longue
salle voûtée en plein-cintre, probablement à usage d'écurie, dont il ne reste plus que l'extrémité
nord. Deux ouvertures obliques, dirigées vers le
haut, permettaient d'aérer la salle. Au-dessus, la petite
porte ouvrant sur l'intérieur de la tour d'angle
N.-E. (fig. 2). Cette porte étant aujourd'hui inaccessible,
on ne sait si le bas de la tour servait de
citerne, comme sa voisine de l'angle N.-O.
En face de soi, on a le haut rempart nord percé d'une poterne
(fig. 2). Ce rempart protège la partie la
plus exposée, du côté où le ressaut
occupé par le château se rattache à la montagne
par une pente
douce. C'est, naturellement là qu'on trouve les murs
les plus épais (2,20 m). Au milieu du rempart, une
grande brèche et un énorme tas de décombres
signalent l'emplacement du donjon, complètement
disparu.

Fig. 2. — Chateau
d'Évol : tour ruinée, au-dessus de l'écurie.
Front nord, poterne et décombres à l'emplacement du donjon
À droite : le rempart oriental avec poterne.

Fig. 3. — Château
d'Évol : les ruines du logis seigneurial.
Au sud-est, le rempart, plus léger, a entièrement
disparu, sauf un pan de courtine et quelques
arrachements prouvent seuls que la tour S.-O. a existé.
Il ne semble pas, du reste, que cette
disparition soit le fait d'une destruction volontaire, mais celui
de l'érosion. En effet, alors que la partie
nord du château repose en grande partie sur la roche,
il n'en va pas de même pour la moitié ou le quart
sud-est basé sur une terre friable et en forte déclivité.
On peut constater que le ravinement a emporté jusqu'aux soubassements des constructions disparues.
À gauche, les portes et fenêtres du logement seigneurial,
très spacieux, composé de 3 salles au rez-de-chaussée et autant à l'étage (fig. 3).
Le seul matériau local est le schiste, roche que la pluie
et le gel délitent à qui mieux mieux et dont les éclats jonchent le sol. Le château d'Évol
est entièrement construit en plaques de schiste, y compris
les encadrements des ouvertures où les claveaux
sont remplacés par des plaques posées de chant
(fig. 4).
Extérieurement, on trouve du côté nord un
embryon de fossé, entaillé dans l'arête du contrefort,
qui ne
constituait pas une défense bien sérieuse. Extérieurement,
du côté sud-ouest, un terre-plein longe le
rempart, formant une terrasse soutenue par un mur en pierre sèche.
Une poterne fait communiquer
celle-ci avec la grande salle ; une seconde poterne, très
étroite, s'ouvre dans un passage ménagé entre
la terrasse et la tour N.-O., elle donne accès à
la petite salle d'angle.
Ce rempart sud-ouest est le seul qui présente une série
d'archères à longue fente du type XIIIe siècle,
cinq pour la grande salle, deux pour la petite salle sud-ouest,
plus deux autres côté midi dans cette
même salle. Très régulièrement espacées,
tous les 2,50 m, elles se poursuivent au sud jusqu'à la
rampe d'accès et certaines d'entre elles sont curieusement
noyées dans des maçonneries ultérieures.
Le
plan ci-dessous est dû à M. et Mme Ristori qui, à
deux reprises, en 1969 et 70, ont campé sur place durant plus
d'une
semaine, et ont eu tout le temps d'étudier les ruines du
château. Ce sont eux qui ont découvert l'existence d'un
grand donjon
circulaire placé presque au milieu du front nord, et, dans
le couloir qui longe le rempart nord-ouest, d'une gaine qui pourrait
être
le puits à neige du château et, tout à côté,
les traces d'un escalier.

Les
accès
De nombreuses poternes donnaient accès au château
: deux sur la terrasse sud-ouest, une sur le
front nord-est et même une dans le rempart nord-ouest au
pied du donjon (voir plus loin). Cependant
on peut penser que certaines d'entre elles, et notamment celles
de la terrasse, ont été pratiquées
après coup.
En fait, l'accès normal était une rampe sinueuse
qui montait sur le flanc sud-est et qui reste marquée
par des débris de maçonnerie. On voit, en particulier,
un gros massif cubique, à mi-pente, dont on ne
comprend pas bien l'utilité.
Passant au pied de la tour d'angle, la rampe était battue
par les archères de l'angle sud et pénétrait
dans la cour intérieure par une porte dont un des côtés
est encore visible dans le rempart.
*
* *
Le
corps du logis
Nous avons dit que le rez-de-chaussée se composait de trois
salles, la plus grande étant au milieu. La disposition des cloisons, qui gênent le service des archères
voisines, semble indiquer une origine
postérieure. Particulièrement, la cloison sud-est,
peu épaisse, doit être d'une époque tardive.
Cet étage n'était pas sous voûte, des arcs
soutenaient le plancher de l'étage supérieur. On peut
encore en voir les arrachements ou les départs tronqués,
trois dans la grande salle, un dans la petite
salle sud. Ils devaient contribuer à donner au logis une
certaine majesté. Les salles ouvrent largement
sur la cour intérieure.
La grande salle possède donc une poterne et 5 archères
vers l'extérieur, une porte et 3 fenêtres sur la
cour, une petite et deux autres plus grandes qui ont pu comporter
des bancs latéraux. Deux ouvertures
donnent également sur la terrasse sud-ouest, elles paraissent
avoir été percées à l'emplacement de
deux archères.
La petite salle sud-est présente une cheminée dont
le manteau a disparu, une porte sur la cour et une
autre vers la grande salle et 4 archères au moins, car
une partie du mur méridional n'existe plus,
probablement emporté par l'effondrement de la tour d'angle,
sapée par l'érosion.
Dans la salle nord-ouest s'ouvre une sorte de gaine, qui devait
être, en fait, un puits à neige. Une
cheminée débouche sur une petite terrasse, tout
contre le gros rempart. Des affleurements laissent
supposer la présence d'un escalier circulaire, noyé
dans les décombres, qui permettait l'accès à cette
terrasse.
*
* *
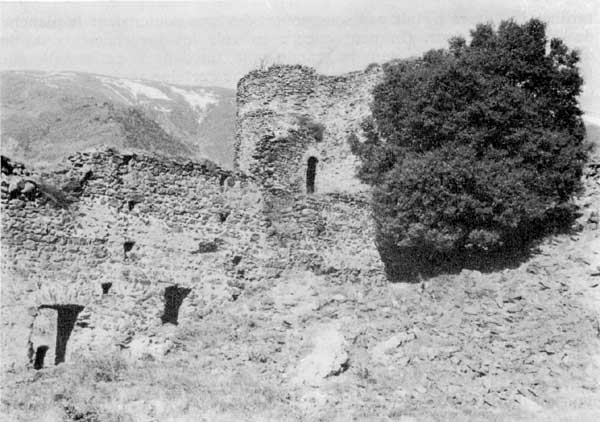
Fig. 4. — Château
d'Évol : porte d'accès à la citerne nord-ouest.
À gauche : les ruines du logis seigneurial.
À droite : les décombres du donjon.
La grosse tour
La grosse tour ouest est particulièrement intéressante
du fait de son bon état de conservation. L'accès
le plus commode est la brèche mentionnée plus haut,
qui traverse sa base talutée. De l'intérieur, on
constate l'existence d'une voûte en coupole munie d'une
trappe rectangulaire. Des traces subsistant
dans les murs montrent également qu'il y avait sous la
voûte deux étages de planchers.
Il est probable que cette tour, aveugle sur la majeure partie
de sa hauteur, a servi de citerne. On ne
peut, cependant, trouver sur les murs aucune trace de l'enduit
rose habituel en pareil cas. Les fouilles
anarchiques pratiquées par des intrus ne permettent pas
de juger avec certitude de la composition
réelle du sol initial.
Si on pénètre dans la tour par la petite porte placée
un peu plus haut que l'étage des logements
(fig. 4), on accède par un couloir étroit, percé
dans la maçonnerie, à la trappe carrée dans laquelle
se déversait une goulotte qui, traversant le mur, devait
apporter l'eau des toitures. Au dessus, une
deuxième voûte supporte le sommet de la tour.
Le donjon
Rien ne manifeste sa présence à première
vue. Toutefois, un examen attentif de la brèche dans le
rempart nord-ouest fait apparaître, parmi les décombres,
un débris de mur légèrement circulaire, de
2,50 m d'épaisseur environ, adossé au pan nord du
rempart. On peut également discerner sur le sol
quelques affleurements qui dénotent l'existence d'une très
grosse tour circulaire, qui ne pouvait être
que le donjon. Très logiquement situé à l'endroit
le plus exposé, il avait un diamètre d'environ 9,50 m,
autant qu'on puisse en juger, avec des murs de 2,50 m. Sa destruction
complète laisse supposer
qu'elle a été conduite volontairement et de façon
systématique.
Une poterne étroite existait entre le donjon et la partie
ouest du rempart, comme le montre la présence
d'une plaque de schiste, de celles qui constituent les cintres
de toutes les ouvertures du château.
On constate que les deux pans du rempart, de part et d'autre du
donjon, ne sont pas alignés. Le pan
nord, simplement adossé au donjon avec lequel il ne faisait
pas corps, a pu être construit postérieurement. Il n'est pas impossible qu'une première construction
ait comporté le donjon et la partie sud-ouest
du château, un agrandissement ayant été pratiqué
ensuite pour constituer la cour intérieure. Il serait
pourtant bien hasardeux, malgré un examen approfondi, d'avancer
des hypothèses précises sur les
stades successifs de la construction.
Haut
de page
|

